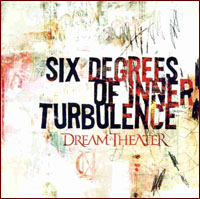DREAM THEATER (usa) - Six Degrees Of Inner Turbulence (2002)

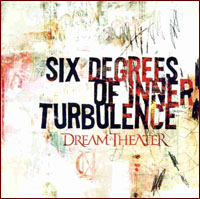
Label : Elektra / East West
Sortie du Scud : 29 janvier 2002
Pays : Etats-Unis
Genre : Abbey Road Post Moderne / Metal Progressif
Type : Album
Playtime : 6 Titres - 96 Mins
En 1999, DREAM THEATER sort ce qui restera pour ses fans son postulat définitif. Inutile d’abuser de superlatifs, Metropolis 2000 fut au Metal progressif ce que furent en leur temps pour le Hard-Rock ou le Rock tout court des albums comme 2112 de RUSH, Tales From Topographic Oceans de YES, The Wall des FLOYD, ou The Lamb Lies Down On Broadway de GENESIS. Une pierre de rosette. Une seule idée de chaque titre a suffit à certains groupes à composer une discographie complète.
Mais, après des perles inusables telles qu’Images And Words, Awake, ou encore Falling Into Infinity, il résonna tel le glas de l’insouciance, le challenge impossible à surpasser, tel le Operation Mindcrime que QUEENSRYCHE porta comme un fardeau tout au long de sa carrière.
Alors en 2002, lorsque des fuites de studio nous autorisèrent à pencher une oreille sur son successeur, la crainte nous envahit. Un seul titre, un rough mix de plus de 40 minutes, la gageure semblait osée, le pari un peu trop téméraire.
DREAM THEATER n’a jamais caché son admiration pour des groupes comme METALLICA, THE BEATLES, ou KING CRIMSON.
Alors osons. Six Degrees Of Inner Turbulence est la plus parfaite synthèse de ces trois ténors que le quintette de Boston ne nous ait jamais offerte.
Des Californiens énervés, ils ont extrait la puissance. Des Fab Four, la construction en gigogne, les mélodies. De la bande à Fripp, les expérimentations sur la durée, l’esprit frondeur et novateur.
En 1986, sortait Master Of Puppets. En 1969, deux pièces essentielles de la Pop créative britannique. In The Court Of The Crimson King, qui en laissa plus d’un sur le carreau, et Abbey Road, chant du cygne d’un groupe dont la légende avait étouffé la créativité individuelle.
En 2002, des américains tentent de cloner l’ADN de ces trois bibles sonores pour en synthétiser une quatrième.
Et de quatre, nous passons à 6 évangiles.
Tout comme Abbey Road, la première face de ce pavé est constitué de chansons individuelles, dont les textes ont été écrits par John, James, Mike, au choix. Mais là ou les BEATLES s’égaraient dans des considérations d’Ego aboutissant à l’autorisation de publication d’extrêmement dispensables brouillons tels que le fumeux « Maxwell’s Silver Hammer » de Paul ou le grotesque et submarinien « Octopus’s Garden » de Ringo, DREAM THEATER épure, purge, et ne retient que l’essentiel.
Ca démarre comme un rêve des Four Horsemen, un léger tapping d’arpèges à la basse, un riff plombé à la Toni Iommi. Et puis, après une cavalcade comme seul l’ami Portnoy est capable de produire, on rentre dans le vif du sujet. C’est sombre, très sombre, même si le sieur Petrucci se permet un solo hystérique. « The Glass Prison », dont les mots furent couchés sur papier par un Mike alcoolique en manque de rédemption, est un piège, plus qu’une prison. C’est l’ouverture en trompe l’œil, qui annonce faussement la suite, en nous guidant sur une fausse piste. Fidèles à une tradition inaugurée dès les premiers jours, DT balance une introduction tapageuse flirtant avec le quart d’heure, au risque de voir l’auditeur un peu perdu dans ce déluge de breaks, de modulations, de digressions sur un Néo Métal envahissant et diablement clinique.
« Blind Faith » qui malgré son titre n’a de commun avec le supergroupe de Clapton que la dextérité, calme, louvoie, ambiance. Inutile de précipiter les débats, il faut s’établir sur la longueur, varier les climats, les développer, les laisser mûrir.
A la lisière d’une Pop-Rock délicate, c’est un morceau qui n’aurait pas détonné sur Falling Into Infity, même coincé entre « Take Away My Pain » et « Anna Lee ». Certains ont évoqué U2, peut être à tort, mais certainement la chanson la plus atypique de l’album.
« Missunderstood » est la première clé de Six Degrees. Celle qui ouvre la pièce secrète, que seuls les initiés pourront pénétrer. En musicologie, on appelle ça un crescendo. La voix de James se fait veloutée, et les arrangements de cordes discrets de Jordan placent la barre plus haut. Le pré refrain avec ses vocaux doublés à l’octave, cette guitare lancinante et pourtant envoûtante, c’est de la magie, soutenue par le grondement lointain des allers et retours de Myung à la basse. Jusqu’à un refrain cathartique, profession de foi ou aveu, c’est à vous de juger. Il est vrai qu’on à trop tendance à juger les musiciens de DT comme des surhommes, ce qu’ils ne sont assurément pas, enfin, pas tout le temps comme le prouvera l’avenir. Mais ici, c’est l’équilibre parfait, il n’y a rien à corriger, même pour les plus exigeants. Et c’est une fois de plus dans un format peu usuel que nous sommes enfermés. Pour transcender les à priori, et chercher plus loin. Métal, Rock, les barrières n’ont plus aucune importance, seule la musique reste.
Et la coda finale de nous mener jusqu’à « The Great Debate », dissertation sur le clonage, ses avancées, ses risques. Et pour un tel thème, le groupe se métamorphose et revient dans des sillages plus agressifs. Les deux minutes d’intro sur fond de discours scientifique sont menées tambour battant par un Portnoy au sommet de son inventivité, soutenu en cette tâche par un Petrucci qui se contente de répéter le même motif, presque en roue libre. La voix au vocoder de James, le rythme hautement syncopé, la guitare quasiment en arrière plan, c’est onirique, et pourtant terriblement pragmatique. « Human kind has reached a turning point » nous crie James. Le groupe aussi, je pense.
Placer « Disappear » en fin de face, est un signe de confiance aveugle. Plus qu’une ballade, plus qu’une Blue Song, elle semble tout droit sortie de l’imaginaire d’une fée, issue d’une union contre nature entre Van Morrison et Tori Amos. Son leitmotiv au piano, ces nappes vocales célestes, elle vous laisse avec la chair de poule, l’esprit confus. Plus qu’ « Another Day » ou « Through Her Eyes », c’est le plus beau testament nostalgique que les américains nous aient offert.
Mais pour arriver au bout de la route, il faut encore marcher, courir, sur la même distance qu’un marathon de l’envie. Et c’est ce qui nous attend justement, sur le second Cd, avec cette pièce consistance, ce fantasme qu’est le title-track, « Six Degrees Of Inner Turbulence ». Décomposée en huit mouvements contrairement à ce que son titre indique, c’est une variation sur le (trop) fameux « The Huge », titre de travail que les BEATLES ont fini par écarteler en autant de morceaux qu’ils avaient d’histoires à raconter. Et tout comme la face B de l’au revoir définitif des mob tops, chaque particule à sa raison d’être, son identité.
La grandiloquence mène la danse en ce début de face, et Jordan nous tisse une toile d’arrangements certes un peu pompeux, mais à l’échelle de l’entreprise. La mélodie est sublime bien sur, mais comment en douter. Et alors que les dernières touches d’ébène et d’ivoire s’agitent dans l’écho, « About To Crash » se veut mid tempo, et les harmonies sont choisies avec parcimonie, car il s’agit de ne pas rater la cible. DREAM THEATER caresse dans le sens du poil. La fin en demie teinte nous débarque directement sur le très puissant « War Inside My Head », deuxième étape de l’aliénation sociale et mentale que nous subissons tous. Illustrant à merveille avec un simple riff tous les traumas dont peu être victime un être humain dans la société moderne, dire qu’il ne sert de prétexte à l’énorme « The Test That Stumped Them All » serait réducteur.
Il n’empêche que ce quatrième mouvement reste le plus Métal du lot, avec en guise de coup fourré, un Portnoy toujours à l’affût, balayant la normalité d’un coup de baguette décalé, pour nous offrir son pattern le plus déstabilisant et bancal de l’album.
James n’est pas en reste, vociférant, invectivant, cherchant par tous les moyens à faire réagir l’auditeur sous ses coups de boutoir. Un pré refrain digne d’une conversation entre un psychiatre psychopathe et son patient ligoté attendant les électrochocs de rigueur enrobe le tout d’une couche de surréalisme surprenant d’efficacité.
Et comme DT n’est pas du genre à laisser ses fans sur un terrain balisé, c’est l’onirique « Goodnight Kiss » qui nous entoure d’un halo de douceur, de nostalgie, et de velléités de baisers sur le front. Délicat comme de la dentelle, ce morceau est d’une beauté sans égale, justement parce que le groupe fait juste ce qu’il faut, sans jamais tomber dans le sirupeux, ou l’exagéré.
Et pour le prouver, si besoin en était, « Solitary Shell » se veut acoustique, avec une patine presque digne de Jethro Tull. L’optimisme est de rigueur, et le rythme guilleret, à grands coups de pied droit sur la pédale de grosse caisse, qui sonne comme un battement cardiaque de nouveau né. On pourrait gloser indéfiniment et consacrer une thèse à ce simple vers, « As a man, he was a danger to himself ». On pourrait le rapprocher de sa propre expérience et en tirer les conclusions qui s’imposent.
Nous sommes tous quelque part les prisonniers d’une coquille solitaire, Calimero des temps modernes…
Simple transition ou réel morceau à part entière, « About To Crash (Reprise) » replace les débats sur un terrain ébouriffé, Rock juste ce qu’il faut, avec un LaBrie qui domine les débats d’une classe époustouflante. Le final épique, valsant au gré des ambiances du soubresaut énergique à la pesanteur lyrique, se broie l’échine sur un final comme seul DT ose encore en faire.
Symphonique, larmoyant, émouvant, qu’importe l’épithète, c’est tout simplement grandiose. Si « The End » avait symbolisé la meilleure épitaphe qui soit pour enterrer la carrière des BEATLES, « Losing Time-Grand Finale » résonne comme un nouveau départ, clôturant quand même la fin d’un chapitre. Mais comme chaque album de DREAM THEATER est un chapitre en lui-même, que conclure ?
Pour beaucoup de critiques, comparer Six Degrees Of Inner Turbulence à Abbey Road des BEATLES semblerait de la pure hérésie. De l’enthousiasme de fan lambda incapable de différencier un chef d’œuvre d’une vulgaire tentative de grandeur pompeuse comme seuls les groupes progressifs savent en accoucher, de temps en temps.
Et pourtant, rien n’est plus vrai. Et qu’on ne me taxe pas d’opportuniste, couchant sur papier ses frustrations musicales. J’ai assez écouté les deux albums pour en arriver à ce jugement, que j’assume pleinement, même si je dois recevoir une bordée d’insultes ou une chape de mépris par la suite.
Car DREAM THEATER, à l’instar des BEATLES, de METALLICA, de KING CRIMSON et de quelques autres, reste encore et toujours un groupe dont la musique me fait oublier le quotidien, et me dire que parfois, la vie vaut d’être vécue. Au moins pour avoir eu le temps de connaître tout ça.
Ajouté : Jeudi 28 Février 2002
Chroniqueur : Mortne2001
Score :     
Lien en relation: Dream Theater Website
Hits: 19368
|